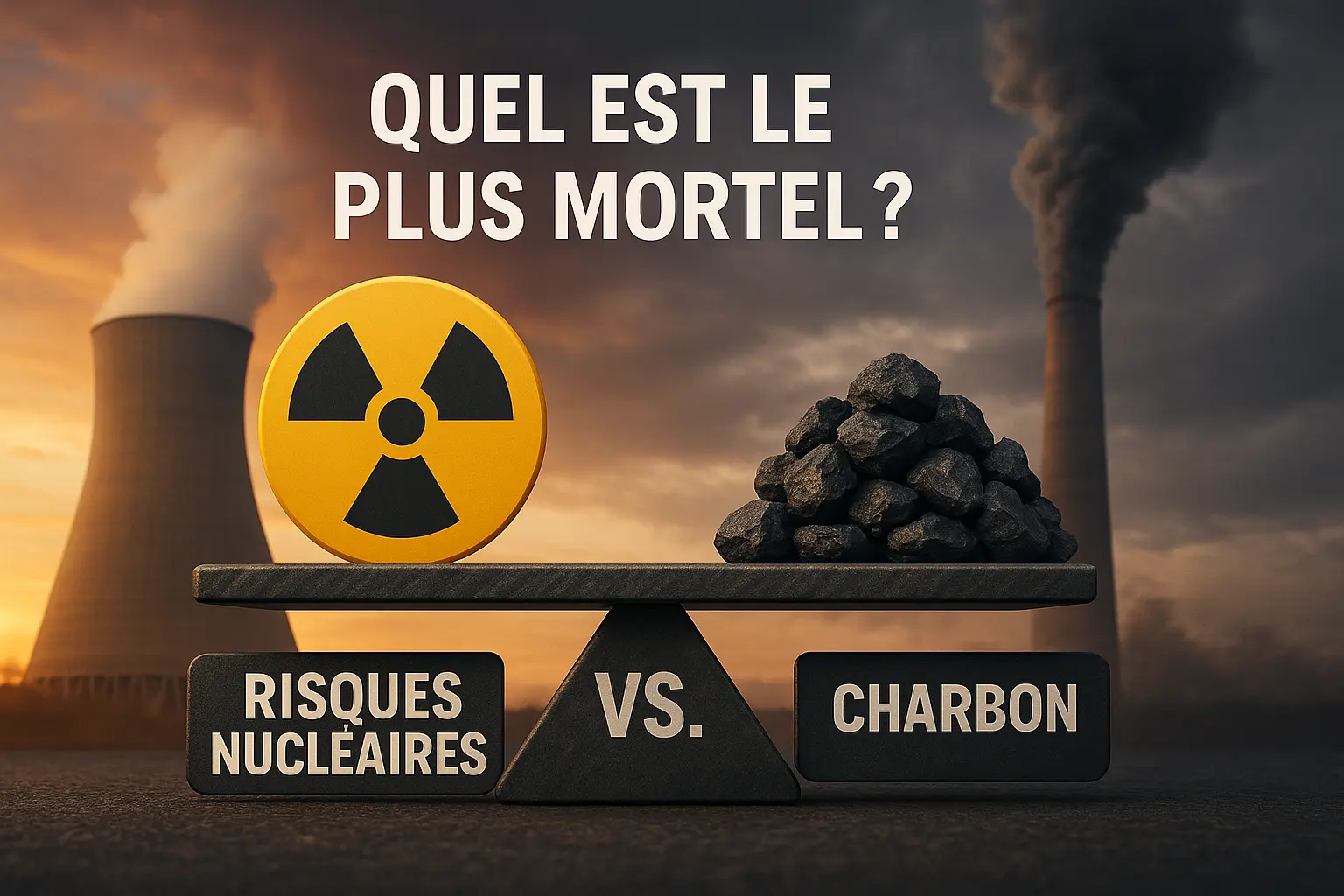Le nucléaire est-il vraiment la menace mortelle que l’on croit, comparé à d’autres sources d’énergie ? En creusant les chiffres de mortalité par térawatt-heure, une réalité inattendue émerge : le charbon tue 820 fois plus que le nucléaire, avec 24,6 décès par TWh contre 0,03 pour ce dernier, incluant les accidents de Tchernobyl et Fukushima. Derrière cette comparaison choc, des données de Our World in Data révèlent un bilan sanitaire inégalé : en remplaçant le charbon, le nucléaire aurait évité 1,8 million de décès depuis 1971. Une analyse froide, mais éloquente, pour départager deux géants de la production électrique.
Mortalité par TWh : une comparaison chiffrée sans appel
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la production d’électricité au charbon est environ 820 fois plus meurtrière que celle du nucléaire. Cette différence colossale s’explique par deux facteurs majeurs : la pollution de l’air liée au charbon et les décès indirects liés à son extraction.
Pour comparer ces sources, les chercheurs utilisent une unité clé : le décès par térawattheure (TWh). Un TWh correspond à la consommation annuelle électrique de 150 000 habitants en Europe. Cette approche mesure tous les risques, de l’extraction du combustible aux accidents d’exploitation, en passant par les effets sanitaires à long terme.
| Source d’énergie | Décès par TWh (Accidents & Pollution) |
|---|---|
| Charbon | 24,6 |
| Pétrole | 18,4 |
| Biomasse | 4,6 |
| Gaz naturel | 2,8 |
| Hydraulique | 1,3 |
| Éolien | 0,04 |
| Nucléaire | 0,03 |
| Solaire | 0,02 |
Source : Our World in Data (2020).
Les 0,03 décès par TWh pour le nucléaire incluent les conséquences des accidents de Tchernobyl et Fukushima, deux événements majeurs qui représentent la quasi-totalité des victimes directes. À l’inverse, les 24,6 décès par TWh du charbon proviennent principalement de la pollution de l’air (90 % des cas), avec des particules fines provoquant des maladies respiratoires, et des accidents miniers (10 % des cas).
Une étude publiée dans Environmental Science & Technology renforce cette analyse. Elle estime que l’utilisation du nucléaire entre 1971 et 2009 a évité 1,84 million de décès, en remplaçant des énergies fossiles. À l’inverse, cette même période n’a enregistré que 4 900 décès imputables au nucléaire, incluant les radiations et les accidents.
Ces données remettent en perspective les risques réels. Si le nucléaire disparaissait et était remplacé par le charbon, entre 4,39 et 7,04 millions de personnes supplémentaires pourraient décéder d’ici 2050. Même avec des marges d’incertitude, cet écart colossal montre que le charbon reste de loin la source d’énergie la plus dangereuse pour la santé humaine.
Ces articles peuvent également vous intéresser:
La pollution de l’air, principal facteur de mortalité du charbon
Le charbon est la source d’énergie la plus meurtrière, avec 24,6 décès par TWh produit contre 0,03 pour le nucléaire. Ces chiffres, selon l’IEA, intègrent les effets cumulés de la pollution chronique sur la santé publique, non les accidents majeurs.
Une étude d’Environmental Science & Technology estime que le nucléaire a évité 1,84 million de décès entre 1971 et 2009 en remplaçant les fossiles. En France, 1 200 morts prématurées annuelles proviennent de la pollution transfrontalière des centrales allemandes et polonaises.
- Particules fines (PM2.5) : pénètrent dans le sang, déclenchant des maladies cardiovasculaires. 460 000 décès aux États-Unis entre 1999-2020 et 22 900 en Europe en 2013 en sont imputables.
- Oxydes d’azote (NOx) : aggravent l’asthme et forment du smog. Ils causent 38 200 crises cardiaques annuelles aux États-Unis.
- Dioxyde de soufre (SO2) : irrite les voies respiratoires. Sa réduction de 90 % aux États-Unis entre 2004-2019 a sauvé 11 000 vies par an.
- Métaux lourds : mercure, plomb et cadmium s’accumulent dans l’environnement. Le mercure contamine les poissons et la chaîne alimentaire humaine.
Les enfants, personnes âgées et asthmatiques subissent des risques accrus. En Europe, les 30 centrales les plus polluantes concentrent 50 % des décès liés au charbon.
Cet impact sanitaire justifie la transition vers des énergies moins polluantes. Selon les projections, remplacer le nucléaire par le charbon entre 2010-2050 pourrait entraîner 4,39 à 7,04 millions de décès supplémentaires. Le nucléaire a évité des centaines de milliers de morts liées au charbon.
Le risque nucléaire : entre accidents et sûreté maîtrisée
Les accidents de Tchernobyl et Fukushima
Tchernobyl (1986) et Fukushima (2011), classés niveau 7 sur l’échelle INES, ont profondément marqué l’histoire nucléaire. Leur bilan humain, bien que grave, reste infime comparé à la mortalité du charbon.
Tchernobyl a causé 2 décès immédiats, 28 décès liés au syndrome d’irradiation aiguë dans les mois suivants, et un excès de cancers thyroïdiens chez les enfants exposés à l’iode 131. À Fukushima, un seul cas de cancer du poumon est suspecté, avec 51 décès indirects liés aux évacuations. Ces chiffres, intégrés au taux de 0,03 décès par TWh du nucléaire, attestent de sa sécurité relative.
Le charbon, responsable de 24,6 décès par TWh, entraîne une mortalité constante. Les rejets radioactifs de Tchernobyl ont contaminé 13 000 km² en Europe, contre 600 km² au Japon. Ces accidents ont renforcé la culture de sûreté mondiale, en intégrant des leçons sur la gestion des rejets et la résilience des installations.
Les leçons de sûreté et l’amélioration continue
Les accidents de Tchernobyl et Fukushima ont révélé des vulnérabilités, provoquant des réformes majeures. Aujourd’hui, la sûreté nucléaire repose sur :
- Renforcement des enceintes de confinement contre des agressions (séismes, inondations).
- Systèmes de refroidissement d’urgence redondants, même en cas de panne électrique.
- « Noyaux durs » : équipements protégés contre les scénarios extrêmes, comme les Diesels d’Ultime Secours (DUS) en béton armé.
- Formation renforcée des opérateurs et procédures standardisées.
- Coopération internationale via l’AIEA pour échanger bonnes pratiques et retours d’expérience.
Ces évolutions font partie d’une démarche proactive. La sécurité en centrale s’est renforcée après Fukushima, avec la Force d’Action Rapide Nucléaire (FARN), interviennent en moins de 24 heures. La recherche, pilotée par l’IRSN, développe des matériaux résilients face aux extrêmes, comme les enceintes en béton armé capables de résister à des vents violents ou des inondations.
Malgré leur gravité, ces accidents ont rendu le nucléaire beaucoup plus sûr. Selon l’IRSN, « la sûreté est un progrès permanent, pas un état acquis ». Cette vigilance explique son avantage sur le charbon en termes de prévention des décès, en évitant des risques diffus liés à la pollution de l’air.
Déchets et radioactivité : une comparaison factuelle
Le débat sur les risques sanitaires du nucléaire et du charbon oublie souvent un fait méconnu : la radioactivité naturelle des cendres de charbon dépasse souvent celle des déchets nucléaires par unité d’énergie produite. Cette réalité, peu médiatisée, bouleverse les perceptions publiques.
La radioactivité méconnue des cendres de charbon
Le charbon contient des éléments radioactifs naturels (uranium, thorium, potassium-40) à des concentrations pouvant atteindre 1000 Becquerels par kilogramme. La combustion concentre ces substances dans les cendres volantes, multipliant leur radioactivité par 7 à 10.
Un gigawatt-heure produit par charbon génère 700 000 tonnes de cendres. En France, les centrales déversent annuellement 1,8 million de tonnes de ces résidus, souvent entreposés dans des bassins à ciel ouvert ou recyclés en béton routier. Ce recyclage disperse la radioactivité dans l’environnement sans contrôle.
L’accident de Kingston (Tennessee, 2008) illustre les risques : le déversement d’1,1 milliard de litres de boues a relâché des niveaux anormaux de césium-137 et d’uranium dans la rivière Emory. Plus de 400 travailleurs ont développé cancers et pathologies respiratoires pendant le nettoyage, souvent sans équipement de protection adapté.
La gestion contrôlée des déchets nucléaires
Pour la même énergie produite, le nucléaire génère 0,2 kg de déchets hautement radioactifs contre 700 tonnes de cendres toxiques. Ces 0,2 kg sont :
- 95% de déchets faible/moyenne activité (vies courtes)
- 5% de déchets haute activité (HAVL) nécessitant un stockage géologique
Les HAVL sont encapsulés dans des colis en verre (vitrification) puis entourés de cuivre ou d’acier inoxydable. Le projet Cigéo en France prévoit de les enfouir à 500 mètres de profondeur dans l’argile de Bure, une formation géologique stable depuis 160 millions d’années.
La filière nucléaire applique une méthodologie stricte pour déterminer comment sont classés les déchets radioactifs afin d’adapter leur mode de gestion. Chaque déchet est tracé depuis sa naissance jusqu’à son stockage, avec des contrôles réguliers.
Sur le même thème, lisez également:
Le calcul inversé : combien de vies le nucléaire a-t-il sauvées ?
Une étude menée par des chercheurs de la NASA et de l’Université de Columbia, publiée dans la revue Environmental Science & Technology, révèle un constat contre-intuitif : l’énergie nucléaire a évité des millions de décès. En substituant des énergies fossiles comme le charbon par le nucléaire entre 1971 et 2009, environ 1,84 million de morts ont été évités, principalement liés à la pollution de l’air.
Les chercheurs ont modélisé les scénarios où l’électricité nucléaire aurait été produite par des combustibles fossiles. Les décès évités incluent ceux causés par les particules fines, les maladies respiratoires et les accidents miniers liés au charbon. À l’inverse, les 4 900 décès imputables au nucléaire sur la même période – majoritairement dus aux accidents de Tchernobyl et Fukushima –, montrent un bilan nettement plus favorable.
Les projections de l’étude soulignent un enjeu critique : si le nucléaire disparaît et est remplacé par le charbon d’ici 2050, cela pourrait entraîner 4,39 à 7,04 millions de décès supplémentaires. Ce calcul intègre les effets cumulés de la pollution et des accidents miniers, souvent sous-estimés dans les débats publics.
Cette analyse rappelle que, malgré ses risques propres, le nucléaire a joué un rôle clé dans la réduction des décès liés à la production d’énergie. La pollution invisible du charbon, omniprésente dans les centrales thermiques, reste un fléau sanitaire majeur, masqué par la rareté médiatisée des accidents nucléaires.
Les chiffres de Our World in Data sont clairs : le charbon (24,6 décès/TWh) est 800 fois plus mortel que le nucléaire (0,03/TWh, accidents inclus). Selon une étude, le nucléaire a évité 1,84 million de décès depuis 1971. Le remplacer par le charbon pourrait causer des millions de morts d’ici 2050. Une réalité sanitaire à considérer dans la transition énergétique.